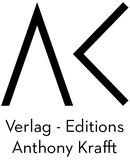Bilan de Part d9aujourd'hui d'après la Biennale de Venise Giulia Veronesi
1. Johannes Itten, Suisse Printemps, 1963. Huile 100 X150 cm 2. Walter Linck, Suisse Pendule II, 1963/64. Fer et acier, 235 cm hauteur 3. Umberto Boccioni, Italie Formes plastiques d'un cheval, 1914 (Collection Sprovieri, Rome) 4. Amadeo Gabino, Espagne Armure sereine, 1966. Aluminium et acier
5. Gunter Haese, Allemagne Le vase de Pandore, 1964 ( Collection Ursula Haese, Düsseldorf) 6. Julio Le Parc, Argentine Cercles potentiels, 1965. Jeux de miroirs 7. Jesus Soto, Venezuela Grand mur panoramique vibrant, 1966 Bois et métal peints
2
Si le rôle d’une exposition biennale est de nous renseigner sur deux années d’art par la réalité des faits et des mouvements, on ne comprend pas pourquoi la critique internationale a été si sévère vis-à-vis de la Biennale 1966 de Venise: pour la première fois (le Pop-Art qui a été le scandale de la Biennale précédente était surtout un phénomène américain), nous voici bien renseignés sur l’unité, à une échelle internationale, des recherches des jeunes artistes dans le domaine du langage: de l’Italie à l’Allemagne, à l’Amérique latine, il s’agit non seulement d’art abstrait (sauf pour quelques essais d’une « nouvelle figuration », entre le Pop-Art et le surréalisme), mais, surtout, de l’art dit « optique », qui s’accompagne d’une recherche de mouvement: c’est le mouvement de l’essence même, la réalité même de ces ombres et lumières changeantes et fuyantes. La Biennale nous dit à quoi les jeunes travaillent: à côté des « optiques », d’autres, en poussant jusqu’à la dernière limite les données de l’abstraction, rejoignent parfois certains résultats du Pop-Art (le choc par la couleur, ou par les dimensions énormes des pièces, par exemple), comme aux Etats-Unis ou en Angleterre. On s’inquiète — dit-on — de la présence de plus
130
en plus envahissante de la science dans la vie, on essaie d’en introduire quelques données dans le royaume de la poésie, dans la «vision». C’est absurde? C’est naïf?
C’est — surtout — illusoire? Qu’importe: le rôle de la Biennale est de nous mettre au courant d’une façon «comparative»; et — cette fois-ci — ça y est.
On peut s’étonner, certes, du fait que les prix aient voulu donner un caractère polémique à cette allure presque partout spontanée de l’art d’aujourd’hui, plutôt que souligner uniquement la qualité des résultats: si l’on comprend le prix de 40 ans de travail passionné et cohérent de Lucio Fontana malgré le manque de violence et de chaleur de 1’« espace » qu’il a présenté à cette Biennale, on a tout de même quelques difficultés à accepter le prix décerné à Julio Le Parc (Argentine), non parce que son art est « optique », naturellement, mais parce qu’il nous apparaît encore bien primitif, à cause surtout du manque absolu de rythme dans les mouvements bruyamment déclenchés par des boutons électriques (ce qu’on ne peut pas reprocher, par exemple, à Schaeffer, qui n’expose pas à Venise). Les prix, d’ailleurs, n’ont qu’un intérêt relatif; la cohérence de l’ensemble est le trait le plus
important et évident de cette Biennale, même dans le choix de deux de ses trois rétrospectives (celle de Giorgio Morandi, organisée par Roberto Longhi, Lamberto Vitali, Gianalberto Dell’Acqua, est un hommage au vieux peintre qui vient de mourir; sa peinture fine et sensible mais pâle et mélancolique, d’un naturalisme poétique tout à fait d’une autre époque, n’a pas grand-chose à voir avec l’art d’aujourd’hui).
La rétrospective Umberto Boccioni, au contraire, n’aurait pu être mieux choisie (c’est Guido Ballo qui l’a organisée): c’est bien lui, Boccioni, l’ancêtre de ces chercheurs du mouvement dans l’expression plastique, dont les œuvres peuplent la Biennale. Au-delà de ses camarades futuristes eux-mêmes, qui ont très vite abandonné et renié, presque tous, ces recherches, Boccioni et son dynamisme plastique rejoignent (on le voit à la Biennale) l’art contemporain dans un de ses courants majeurs. Ce qui place Boccioni à un niveau très élevé (à part la grande beauté de son œuvre) est le fait que le mouvement qu’il poursuit, au point de départ de cette recherche bergsonienne du «temps» rendu visible et sensible par le rythme, n’est pas naïvement physique, mais rigoureusement
pictural (car enfin, si l’on veut refuser et tuer la peinture et tout l’art, pourquoi diable expose-t-on à Venise?).
L’autre rétrospective est la première exposition d’ensemble du groupe d’artistes qui, entre 1933 et 1940, ont donné naissance en Italie au mouvement de l’art abstrait, en pleine réaction néo-classique.
C’est Nello Ponente qui a organisé cette exposition intéressante et à peu près inédite, dont le critique et l’histoire de l’art abstrait européen ne peuvent négliger les données principales. Les artistes exposant sont: Badiali, Bogliardi, Ghiringhelli, Licini, Munari, Radice, Reggiani, Rho, Soldati et Veronesi, peintres; Fontana, Galli, Melotti, sculpteurs.
Dans le pavillon italien on retrouve aussi Burri, de plus en plus rapproché de la « peinture », bien qu’informelle; les sculpteurs Alberto Viani (à qui on a décerné un grand prix), un «classique» de la sculpture contemporaine; Nino Franchina, Lorenzo Pepe, Pietro Cascella, trois « abstraits » bien connus; Eugenio Carmi, très intéressant avec ses plaques roulantes et transparentes, et Bruno Munari, avec un appareil caléidoscopique. La présence des jeunes y est importante: entre les espaces blancs et rythmés de Castellani et les
panneaux de Bonalumi, Scheggi, Santoro, plusieurs jeunes artistes montrent un visage de l’Italie inconnu jusqu’ici à la Biennale: Augusto Perez en est un.
Voyons maintenant, en un bref défilé, les autres pavillons. La Suisse, d'abord, qui nous propose aussi un aperçu rétrospectif (et actuel) sur l’œuvre d’un des premiers peintres intéressés aux jeux d’équivalences optiques et rythmiques, dont il a été longtemps professeur (du Bauhaus, entre 1920 et 1923, jusqu’à la Kunstgewerbeschule de Zurich): Johannes Itten. L’autre Suisse est le sculpteur Walter Linck, auteur de « mobiles » métalliques d’une abstraction très pure malgré quelques titres trompeurs (La chatte, Fenêtre vers le ciel, etc.) : deux artistes parfaitement inscrits dans le climat de cette Biennale.
En France, au contraire, l’ensemble n’est représenté que par une mosaïque d’artistes très divers, dont les plus importants ne sont même pas français (comme Victor Brauner et Gérard Schneider); c’est à un Français qu'on a décerné un des premiers prix, le sculpteur Etienne Martin, une force de la nature, qui ne va pas au-delà d’un art informel de grande taille.
Passons à l’Espagne, qu’il faut juger comme la meilleure parmi les sections
étrangères à Venise, pour l’équilibre et la variété du choix, aussi bien que pour la haute qualité de toutes les œuvres exposées.
Amadeo Gabino est un très grand sculpteur, avec ses compositions en aluminium et acier, dont le souffle vigoureux et mystérieux assume à la poésie l’abstraction — ni géométrique ni informelle — de ses grandes pièces. Juan Genoves, peintre, n’est pas moins intéressant, dans sa recherche d’une solution tout à fait actuelle (où l’évocation picturale monochrome de l’effet photographique est, croyons-nous, absolument originale) du problème «figuratif »; on peut dire la même chose (photo à part) pour Salvador Soria, tandis que les étranges miroirs peints de Eduardo Sanz se rallient à l’avant-garde « op » européenne. Il y a Francisco Peinado, il y a Andrés Alfaro, et les graveurs, et tous les autres: tous (ils ont été choisis avec une rare intelligence par Luis Gonzalés Robles) jouent un rôle très précis et très clair dans ce riche ensemble (26 exposants), qui nous montre l’Espagne en train de rechercher une solution à la crise actuelle du langage (évidente dans le monde entier) dans une solution consciente de la crise de «contenu» qui en est la cause, et qui ne 131
peut que s’identifier avec une recherche de liberté expressive absolue.
Avec l’Espagne, c’est l’Allemagne qu’il faut situer en première ligne, par la qualité exquise de l’œuvre, étrange et unique, de son sculpteur Günter Haese, par la force de G.F. Ris, sculpteur aussi, et de Horst Antes, peintre; c’est l’Angleterre, avec Anthony Caro et ses immenses structures métalliques peintes, avec Richard Smith, dont l’œuvre non figurative n’a pas été insensible aux suggestions du Pop-Art, avec Robyn Denny, silencieux et secret comme un Klee « grandeur parois ». Sur les Etats-Unis, évidemment, le souffle du Pop-Art est passé avec une violence dont on perçoit les traces dans l’œuvre d’artistes, (Kelly, Frankenthaler et Olitzki), très éloignés de n’importe quelle figuration; le Pop-Art y est tout de même représenté par Roy Lichtenstein, dont l’œuvre (par exemple dans le bien connu « Temple d’Apollon ») constitue la plus efficace « critique à la peinture » (c’est de l’ironie pure) que les temps modernes, depuis Dada, aient conçue.
Le petit Pop-Art suédois, de Öyvind Fahlström, rentre dans ce courant de la « nouvelle figuration » qui se veut l’antagoniste de l’art optique: art abstrait (celui-ci) poussé jusqu’aux dernières conséquences de son programme, jusqu’à l’absolu caché derrière l’aspect ordinaire des
132
objets. On réagit à l’esclavage de la vision, de l’intelligence et de l’expression à cet aspect: c’est cela l’art contemporain, pop ou op: une protestation, et une déclaration d’indépendance. La même que Curt Stenvert (l’un des « scandales » de cette Biennale) étale dans le pavillon de l’Autriche, à côté de l’œuvre des sculpteurs Bertoni et Kedl et du dessinateur Paul Flora, un Kubin de nos jours. Entre le surréalisme et le Pop-Art, les figures de Stenvert, glaciales et angoissantes, ont figé dans la mort de l’objet (il y a par exemple, un tête féminine en cire, allongée dans un châsse en verre et qui « veut pouvoir respirer la mort... ») toutes les images allusives d’une lourde réalité sociale.
C’est, dit l’auteur, qui n’a pas oublié l’univers des camps, un « art fonctionnel, un art pour l’homme...»: et même, «un manifeste ». Avec les Espagnols Soria et Genoves, c’est Stenvert le plus explicite, à cette Biennale, dont la signification (mais les organisateurs ne s’en doutaient certainement pas) n’est autre que celle-ci.
Il ne reste qu’à louer la section danoise, pour la grande exposition du sculpteur Jacobsen; la section du Brésil, pour les gravures de Piza, la peinture de Duke Lee et les blancs panneaux trépidants de Camargo, la section du Vénézuela, surtout pour la musique métallique des œuvres de Soto, celle de la Hollande, où
l’on voit l’œuvre de peintre, d’urbaniste et d’architecte de Constant, l’un des peintres du Cobra. D’autres artistes isolés devraient être nommés, y compris des Italiens; mais une certaine peinture, même excellente (telle la peinture de Paulucci, de Corpora ou Dorazio) n’entre pas dans un bilan de l’art «actuel». Quant au Japon, le premier et le plus sonore scandale de la Biennale 66, ce n’est qu’une bizarrerie très voyante mais très froide.
Le bilan? Positif, sans hésitation.
Et pourtant, au-delà du bilan et de la Biennale, cet art nouveau, qui dédaigne les pinceaux pour choisir ses instruments parmi la petite machinerie parce que «c’est le temps des cosmonautes... le temps de la mécanique... », est peut-être la grande erreur de notre siècle. Car enfin, l’enfant du cosmonaute, et le cosmonaute lui-même, et M. Ford et M. Einstein eux-mêmes, de leur vivant, ne les voyez-vous pas, seuls sur une plage, lorsque, dans le silence des appareils, ils n’entendent que la voix de leur vie secrète, ne les voyez-vous pas en train de tracer sur le sable, avec une branche de genêt, une arabesque toute simple, une ligne pure?
Eh bien, c’est cela. Ce n’est que cela, peut-être.
Giulia Veronesi