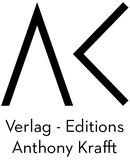Travail heureux | C. F. Landry
Nous passons le plus clair de notre vie au travail; les fameux trois «8», huit heures de sommeil, huit heures de travail, huit heures de loisirs sont très factices. Il faudrait plutôt dire que les avenues du travail prennent encore beaucoup sur les loisirs, et que les nécessités de la vie journalière font le reste.
Ainsi donc, sauf à l’heureux et court temps des vacances, nous avons deux activités : dormir et travailler.
Mais d’où vient que, si les artistes (j’entends les vrais) ont déclaré qu’il fallait aller à son travail comme au bureau (ce sont à peu près les paroles d’un Baudelaire et du peintre Renoir), tant de gens n’ont pas, pour leur bureau, un goût si prononcé ? La question n’est pas simple.
C’est assez drôle de voir que tant de gens sont en conflit avec la vie, parce qu’ils se sentent incompris. Ce n’est pas toujours formulé, ou même formulable. Je regardais, dans un vieux bureau du centre de Paris, la grimace que faisait une vieille secrétaire aux prises avec un tiroir. On sentait que ce tiroir restait mal croché à tous les coups. On sentait que la femme le savait. Pour un peu, j’aurais parié qu’elle disait, mentalement: « Sale bête, je vais t’apprendre ! » Elle disait cela depuis vingt ans, et le tiroir n’apprenait rien.
C’est avec ces choses-là qu’on s’aigrit l’estomac.
Et voilà L.-M. Campiche qui, depuis des années, organise le bureau complet ; pas si simple que cela ; il fallait penser aux autres, aux difficultés des autres ; ce n’est pas une simple entreprise, sinon il faudrait aussi dire qu’un médecin n’est qu’un marchand de santé, sans plus... Et justement, c’est le surplus qui compte.
L’homme qui ne saurait pas ces choses ne pourrait les méconnaître longtemps : alors qu’il serait en pleine dictée, en plein travail à chaud, qui avance vite et qui plane haut — s’il se voyait arrêté par une défaillance du matériel, s’il devait voir sa collaboratrice la plus proche crispée, irritée contre une machine bloquée, contre un papier qui se place mal... — il aurait tôt fait de calculer ce que représentent ces fâcheuses défaillances.
A cent vingt à l’heure, un essuie-glace qui cesse de fonctionner est déjà un danger redoutable ; un capot qui se décroche (bien qu’encore retenu par une sûreté) vous force à l’arrêt sur quelques mètres. Pourtant, quoi de plus étranger au voyage qu’un essuie-glace ou la tôle d’un capot ? Et dans l’intense travail d’une affaire, quoi de plus étranger aux affaires qu’un papier qui s’engage mal ou deux lettres qui montent, étranglant la frappe ?...
Doit-on demeurer en suspens, alors que l’on donnait des précisions à son correspondant d’outreAtlantique... parce qu’il faut attendre qu’une employée modèle ait gommé une erreur ?
C’est alors que le chef d’entreprise se souviendrait que sa secrétaire lui a dit, plus de vingt fois : « Monsieur, cette machine devrait être changée...
Monsieur, cette réparation n’a rien donné. Il nous faudrait un classeur qui... » Ce qu’il faudrait ?
Elle le sait.
C’est pourquoi si, dans une grande maison comme Campiche, on a pu écrire « le client a toujours
raison » sur la couverture d’un prospectus, dans toute saine entreprise, le patron sait que sa secrétaire a aussi toujours raison.
Elle aime ce travail ; ce travail devenu depuis l’aube du siècle un travail de précision, et de haute précision. Elle réclame les outils de ce travail ; elle ne peut pas gagner la course sur un tacot ; elle demande une voiture de course.
Et ce n’est pas une machine seulement, ou une machine plutôt qu’une autre, un système plutôt qu’un autre. C’est tout l’équipement qui l’entoure, c’est ce complexe d’un bureau, c’est la machinerie delicate qui va d’un éclairage à un chauffage, de tiroirs qui s’ouvrent sur galets, à des meubles étudiés.
Une innovation apportée semble « un rien ».
Comme s’il y avait des « riens » dans la vie active.
« Il n’y a pas de détails dans l’exécution », disait Léonard de Vinci. Et cet inventeur au regard d’horloger n’aurait pas fait fi d’un seul détail.
Nous avons tous longuement dactylographié sur toutes sortes de machines, mais qui, toutes, nous fatiguaient bientôt les yeux. C’était hier : touches brillantes, petits cercles de nickel, lettres sous un mince disque de verre ou de celluloïd. Autant de miroirs blessants.
Où est-il le temps où il fallait aller voir par soimême, derrière la grosse machine de bureau, ce que devenaient les margeurs ? « Une belle lettre incite à lire », dit un prospectus de Campiche pour l’Hermès ; et pourquoi ne pas pousser les choses et dire : « Une machine moderne incite à écrire » ?
Je connais des gens qui sont encore un peu « gauches » devant la machine à écrire. « Elle ne me permet pas de dire tout ce que je veux », me confiait récemment un médecin. Et pourtant, il conduit une auto toute la journée, qui lui permet d’aller partout — et pour un médecin de campagne, on sait ce que ça veut dire.
Plus les petites inventions-retouches perfectionnent le bureau et les machines, le classement, les fiches, les meubles de bureau, les éclairages... et plus on arrive à « faire dire » précisément à ce que doit être toute affaire, ce qu’elle avait à dire et qui parfois était entravé.
Nous sommes désormais sortis de l’à-peu-près. Or, l’à-peu-près est toujours générateur d’irritation, l’irritation gâte les nerfs, et les nerfs mal en point ouvrent la porte à toutes les maladies. Moins d’hommes d’affaires vaguement « tendus », moins de secrétaires et de dactylos nerveuses, ce sont les résultats certains, et à brève échéance, pour qui sait comprendre.
Et je me demande, moi, si derrière l’aménagement moderne d’un moyen de travail, ne se cache pas une manière détournée d’inventer des vacances. Le travail heureux perd son côté d’accablement ; le travail aisé est presque une façon de jeu. Il y a dans toute action équilibrée une promesse de détente, de santé, et même d’exaltation.
La beauté d’un travail est nourriture. On ne va pas au travail seulement pour gagner sa vie, mais encore pour justifier sa vie.
La possibilité matérielle de faire du beau travail, souple, sain et rapide, est une source certaine de joie, donc aussi de santé.